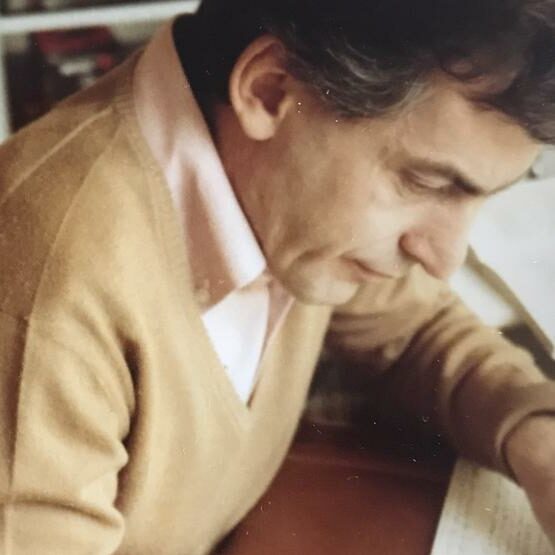
04 Jan Jean Lojkine (1939-2022)
Jean Lojkine nous a quitté-es récemment. L’AFS adresse toutes ses condoléances à ses collègues et à ses proches. Nous reprenons ici un texte d’hommage rédigé par Louis Queré pour le CEMS (Centre d’étude des mouvements sociaux) dont Jean Lojkine était membre.
Outre qu’elle m’attriste, la disparition de Jean Lojkine m’incite à évoquer un moment faste de la vie du CEMS. Créé en 1969 à l’initiative d’Alain Touraine, pour remplacer le Laboratoire de sociologie industrielle (datant de 1958), le CEMS est très vite devenu un des principaux foyers de la sociologie urbaine française des années 1970 (avec le Centre de Sociologie Urbaine et le CERFI, notamment), et plus précisément d’une « école française de sociologie urbaine marxiste ». Les thèmes de recherche de l’époque étaient : les restructurations urbaines au profit du capitalisme monopoliste d’État, les logiques des acteurs privés de la promotion immobilière, l’émergence de mouvements sociaux urbains nés de contradictions croissantes autour des enjeux liés à l’appropriation des espaces de la ville (logement, transports, cadre de vie…), etc.
Jean Lojkine en a été un des principaux acteurs, dès son recrutement au CNRS, avec Michel Amiot (agrégé de philosophie comme lui), Francis Godard, Manuel Castells, et plus tard Eddy Cherki, Dominique Mehl et Nathalie Viet-Depaule. Un de ses premiers ouvrages portait sur la politique urbaine en région parisienne. La référence au marxisme n’était cependant pas uniforme parmi ces chercheurs : face à un Castells qui se réclamait du marxisme structuraliste de Louis Althusser et de Nicos Poulantzas, Jean Lojkine et Francis Godard s’inspiraient plutôt de celui du Parti communiste français.
Christian Topalov, lui aussi un des promoteurs de cette « école française », et proche de Jean Lojkine, a parfaitement décrit le contexte socio-politique de ce développement, qui durera une dizaine d’années, notamment le rôle des administrations chargées de l’aménagement et de l’urbanisme et la création de nouveaux dispositifs de financement de la recherche (cf. Topalov, 2013). Un premier grand appel d’offres auquel ont répondu plusieurs membres du CEMS avait été lancé en 1969 sur « la participation au pouvoir urbain ». À partir de ce moment, « le financement de la “recherche urbaine” connaît une courbe brusquement ascendante : il est multiplié par plus de cinq entre 1969 et 1976 » :
« Les partenaires changent, des deux côtés. Ceux qui gèrent les programmes dans les ministères forment des équipes spécialisées. Leurs rapports sont lointains avec les organismes opérationnels de l’aménagement urbain ; ils sont proches, en revanche, de hauts fonctionnaires de l’État gaulliste, troublés par les secousses sociales et les difficultés que rencontre leur projet modernisateur. Les gestionnaires des programmes de recherche établissent en même temps une complicité avec un milieu de chercheurs qu’ils ont fait naître et qui dépend entièrement d’eux. Les contrats financent les enquêtes et les salaires de jeunes diplômés issus de l’université de masse et recrutés directement, hors de l’allégeance aux patrons de la discipline. […] Cet étonnant mariage entre de jeunes savants critiques du pouvoir et une technocratie dont les certitudes sont ébranlées va faire naître une sociologie urbaine critique qui affiche un nouveau programme : il ne s’agit plus de mieux adapter l’urbanisme aux besoins des citadins, mais d’analyser la production capitaliste de la ville, les politiques urbaines de l’État et les mouvements sociaux qui contestent celles-ci. Les travaux se multiplient, combinant revendications théoriques fortes et enquêtes de terrain ; les rapports de recherche s’accumulent, une très petite partie d’entre eux aboutissant à des formes de publication visibles ».
Tout cela change dès le début des années 1980 : les crédits pour la recherche urbaine s’effondrent. Commencent alors une éclipse de la discipline et la réorientation des chercheurs vers d’autres thèmes de recherche.
Topalov jette un regard quelque peu désabusé sur cette sociologie urbaine critique des années 1970. Certes elle se voulait militante, et poursuivait un projet de transformation sociale, mais les questions que posaient ses promoteurs « regardaient la ville du point de vue des politiques conduites par les ministères » :
« Les questions de Castells, Lojkine ou Topalov avaient pour origine une discussion critique des politiques urbaines “capitalistes”, dans la perspective de changer les choses radicalement. Ils voulaient mettre en cause l’État, mais, sans le savoir, ils demeuraient fascinés par celui-ci. Ils adoptaient un point de vue d’État, un point de vue de gouvernement, un point de vue d’en-haut sur le monde social. Un point de vue qui, comme toujours en sciences sociales, permettait de voir certaines choses et qui interdisait d’en voir d’autres. Les sociologies urbaines qui voulaient se mettre au service de la planification comme celles qui voulaient en faire une critique radicale se trouvèrent les unes et les autres au même moment orphelines des interlocuteurs qui leur permettaient d’exister : les planificateurs. Car cette planification urbaine qui, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était relativement sûre d’elle-même sous la conduite de professionnels disposant d’une doctrine, d’un savoir-faire, d’une légitimité et de ressources publiques importantes, avait commencé à plier sous les coups des doctrines et des forces de la révolution conservatrice néo-libérale ».
Jean Lojkine n’aurait sans doute pas adhéré à cette autocritique radicale, car il n’a jamais renoncé à donner une dimension critique à son travail sociologique, c’est-à-dire à le mettre au service d’un projet de transformation sociale et politique. C’est ce dont témoigne aussi sa reconversion thématique après son investissement dans la sociologie urbaine française des années 1970. Désormais ce sont les transformations du capitalisme contemporain, la « révolution informationnelle », son impact sur les mutations du travail, sur les relations professionnelles, sur la gestion des entreprises et des administrations, et la « nouvelle modernité » qu’elle rend possible, les « nouvelles luttes de classes » et les mouvements sociaux qui combattent pour « une nouvelle civilisation post-capitaliste », qui retiendront son attention, et donneront lieu à plusieurs ouvrages de sa part. Convaincu que les usages sociaux des nouvelles technologies de l’information portent toujours en eux la possibilité d’un choix, contradictoire, entre plusieurs politiques, Jean Lojkine s’opposait au déterminisme technologique des théories de la révolution numérique et du capitalisme cognitif.
On ne peut cependant pas lui reprocher d’avoir cédé à une conception militante de la recherche sociologique. Certes il a continué à participer aux commissions thématiques du PCF et aux initiatives de la Fondation Gabriel-Péri, un groupe de réflexion du PCF. Et il avait des convictions communistes solides, mais toujours bien étayées. Cependant il a toujours tenu à satisfaire les exigences d’autonomie et de rigueur du travail intellectuel et à honorer l’éthique spécifique de la recherche scientifique, tout en considérant que l’enquête sociologique aborde les faits à la fois comme obstacles et comme ressources pour transformer une situation insatisfaisante.
Comme l’a rappelé Pierre-Michel Menger, dans son récent message au CEMS, « c’était un sociologue très cultivé et très talentueux, un collègue à la déontologie impeccable, et un homme plein d’humanité généreuse ».
Louis Quéré, 9 décembre 2022
Source : Site du CEMS



